Je ne peux pas me tromper en disant « J’ai mal ». Et c’est bizarre, quand on y pense.
Quelques passages du Cahier Bleu et des Recherches philosophiques de Wittgenstein qui parlent de tout ça :
« Il y a deux cas différents d’utilisation du mot « je » (ou « mon »), et je pourrais les appeler « l’utilisation comme objet » et « l’utilisation comme sujet ». Voici des exemples de la première sorte d’utilisation : « Mon bras est cassé », « J’ai grandi de quinze centimètres », « J’ai une bosse sur le front » (…). Voici des exemples du second type : « Je vois ceci ou cela », « J’essaie de lever mon bras », « Je pense qu’il va pleuvoir », « J’ai mal aux dents ». On peut indiquer la différence entre ces deux catégories en disant : les cas de la première catégorie impliquent la reconnaissance d’une personne particulière, et dans ce cas il y a possibilité d’erreur (…). Il est possible par exemple, dans un accident, que je sente une douleur dans mon bras, que je voie un bras cassé à côté de moi, et que je pense que c’est le mien, alors qu’en réalité c’est celui de mon voisin. Et, en regardant dans un miroir, il se pourrait que je confonde une bosse sur son front avec une bosse sur le mien. (…) Au contraire il n’est pas question de reconnaître qui que ce soit lorsque je dis « J’ai mal aux dents ». Demander « Es-tu certain que c’est toi qui as mal ? » serait absurde. (…) Il est tout aussi impossible qu’en énonçant « J’ai mal aux dents » je confonde une autre personne avec moi-même, qu’il est impossible de gémir de douleur par erreur, en ayant confondu quelqu’un d’autre avec soi. Dire « j’ai mal » n’est pas plus un énoncé sur une personne déterminée que gémir ne l’est. »
« 258 — Imaginons le cas suivant. Je veux tenir un journal sur le retour périodique d’une certaine sensation. À cette fin, je lui associe le signe “S” et chaque jour où j’éprouve cette sensation, j’écris ce signe sur un calendrier. — Je remarquerai d’abord qu’il n’est pas possible de formuler une définition de ce signe. — Mais je peux néanmoins m’en donner une à moi-même à la manière d’une définition ostensive ! — Comment cela ? Puis-je désigner la sensation ? — Pas au sens habituel. Mais je dis ou écris le signe “S”, et en même temps, je fixe mon attention sur la sensation. — Je la désigne donc, pour ainsi dire intérieurement. Mais à quoi bon ce cérémonial ? Car cela semble n’être qu’un cérémonial ! Une définition sert en effet à établir la signification d’un signe. — Justement, c’est ce que produit la fixation de l’attention ; grâce à elle, je grave dans ma mémoire la connexion entre le signe et la sensation. — Or « je la grave dans ma mémoire » peut seulement signifier : Ce processus a pour effet de me permettre de me souvenir correctement de cette connexion à l’avenir. Mais dans notre cas je ne dispose d’aucun critère de correction. Ici on aimerait dire : Est correct ce qui me semblera toujours tel. Et cela veut seulement dire qu’ici, on ne peut rien dire du “correct”.
259 — Les règles du langage privé sont-elles des impressions de règles ? — La balance sur laquelle on pèse les impressions n’est pas l’impression d’une balance. (…)
261 — Quelle raison avons-nous d’appeler “S” le signe d’une sensation ? “Sensation” est en effet un mot de notre langage commun, et non un mot d’un langage que moi seul comprendrais. L’emploi de ce mot requiert donc une justification qui soit compréhensible par tous. — Et il ne servirait à rien de dire : Ce n’est pas nécessairement une sensation ; celui qui inscrit “S” éprouve quelque chose — et nous ne pouvons rien dire de plus. Mais “éprouver” et “quelque chose” appartiennent également au langage commun. — Aussi en vient-on, quand on philosophe, à ne plus vouloir proférer qu’un son inarticulé. (…)
263 — « Je peux m’engager (intérieurement) à appeler CELA “douleur” à l’avenir. » — « Mais es-tu bien certain de t’y être engagé ? Es-tu sûr que, pour t’y engager, il te suffisait de fixer ton attention sur ce que tu ressentais ? » — Étrange question. — (…)
272 — S’agissant d’expérience privée, l’essentiel n’est pas, à proprement parler, que chacun en possède son propre exemplaire, mais que nul ne sache si les autres possèdent aussi cela, ou autre chose. Il serait donc possible de supposer — bien que ce ne soit pas vérifiable — qu’une partie de l’humanité aurait une impression de rouge, tandis qu’une autre partie en aurait une autre.
273 — Mais qu’en est-il du mot “rouge” ? — Dirais-je qu’il désigne quelque chose à quoi « nous sommes tous confrontés », et que chacun de nous devrait aussi avoir un mot pour désigner sa propre impression de rouge ? Ou bien en est-il ainsi : Le mot “rouge” désigne quelque chose connu de nous tous, mais aussi, pour chacun de nous, quelque chose qu’il est seul à connaître ? (…)
293 — Si je dis de moi-même que je sais seulement à partir de mon propre cas ce que signifie le mot “douleur”, — ne faut-il pas que je le dise aussi des autres ? Et comment puis-je donc généraliser ce seul cas avec tant de désinvolture ?
Eh bien, tout le monde vient de me dire qu’il ne sait qu’à partir de son propre cas ce qu’est la douleur ! — Supposons que chacun possède une boîte contenant ce que nous appellerons un “scarabée”. Personne ne pourrait jamais regarder dans la boîte des autres ; et chacun dirait qu’il ne sait ce qu’est un scarabée que parce qu’il a regardé le sien. — En ce cas, il se pourrait bien que nous ayons chacun, dans notre boîte, une chose différente. On pourrait même imaginer que la chose en question changerait sans cesse. — Mais qu’en serait-il si le mot “scarabée” avait néanmoins un usage chez ces gens-là ? — Cet usage ne consisterait pas à désigner une chose. La chose dans la boîte ne fait absolument pas partie du jeu de langage, pas même comme quelque chose : car la boîte pourrait aussi bien être vide. — Non, cette chose dans la boîte peut être entièrement “supprimée” ; quelle qu’elle soit, elle s’annule.
Cela veut dire : Si l’on construit la grammaire de l’expression de la sensation sur le modèle de l’“objet et sa désignation”, l’objet perd toute pertinence et n’est plus pris en considération. »

 Mais quand j’énonce quelque chose au sujet de Moïse, suis-je dans tous les cas prêt à substituer à « Moïse »
Mais quand j’énonce quelque chose au sujet de Moïse, suis-je dans tous les cas prêt à substituer à « Moïse »  En pratique, si on vous demandait quel phénomène est un critère de définition et quel phénomène est un symptôme, vous seriez dans la plupart des cas incapables de répondre à cette question, à moins de prendre arbitrairement une décision
En pratique, si on vous demandait quel phénomène est un critère de définition et quel phénomène est un symptôme, vous seriez dans la plupart des cas incapables de répondre à cette question, à moins de prendre arbitrairement une décision 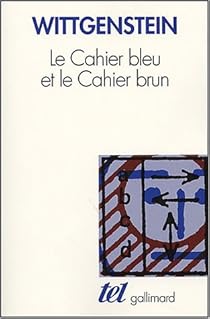
 « Supposez que l’un d’entre vous soit omniscient, et que par conséquent il ait connaissance de tous les mouvements de tous les corps, morts ou vivants, de ce monde, qu’il connaisse également toutes les dispositions d’esprit de tous les êtres humains à quelque époque qu’ils aient vécu, et qu’il ait écrit tout ce qu’il connaît dans un gros livre ; ce livre contiendrait la description complète du monde.
« Supposez que l’un d’entre vous soit omniscient, et que par conséquent il ait connaissance de tous les mouvements de tous les corps, morts ou vivants, de ce monde, qu’il connaisse également toutes les dispositions d’esprit de tous les êtres humains à quelque époque qu’ils aient vécu, et qu’il ait écrit tout ce qu’il connaît dans un gros livre ; ce livre contiendrait la description complète du monde.![Ludwig_Wittgenstein___par_Christiane_[...]Chauviré_Christiane_bpt6k4814374k.JPEG](https://monsieurphi.com/wp-content/uploads/2018/07/ludwig_wittgenstein___par_christiane_-chauvirc3a9_christiane_bpt6k4814374k.jpeg?w=144&h=260) « Mon livre consiste en deux parties : celle ici présentée, plus ce que je n’ai pas écrit. Et c’est précisément cette seconde partie qui est la partie importante. Mon livre trace pour ainsi dire de l’intérieur les limites de la sphère de l’éthique, et je suis convaincu que c’est la seule façon rigoureuse de tracer ces limites. En bref, je crois que là où tant d’autres aujourd’hui pérorent, je me suis arrangé pour tout mettre bien à sa place en me taisant là-dessus. »
« Mon livre consiste en deux parties : celle ici présentée, plus ce que je n’ai pas écrit. Et c’est précisément cette seconde partie qui est la partie importante. Mon livre trace pour ainsi dire de l’intérieur les limites de la sphère de l’éthique, et je suis convaincu que c’est la seule façon rigoureuse de tracer ces limites. En bref, je crois que là où tant d’autres aujourd’hui pérorent, je me suis arrangé pour tout mettre bien à sa place en me taisant là-dessus. » Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n’y aura plus de mots pour l’exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot dont le sens sera délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. (…) Chaque année, de moins en moins de mots, et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Il n’y a plus, dès maintenant, c’est certain, d’excuse ou de raison au crime par la pensée. C’est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais même cette discipline sera inutile en fin de compte. La Révolution sera complète quand le langage sera parfait. (…) Vous est-il jamais arrivé de penser, Winston, qu’en l’année 2050, au plus tard, il n’y aura pas un seul être humain vivant capable de comprendre une conversation comme celle que nous tenons maintenant ?
Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n’y aura plus de mots pour l’exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot dont le sens sera délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. (…) Chaque année, de moins en moins de mots, et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Il n’y a plus, dès maintenant, c’est certain, d’excuse ou de raison au crime par la pensée. C’est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais même cette discipline sera inutile en fin de compte. La Révolution sera complète quand le langage sera parfait. (…) Vous est-il jamais arrivé de penser, Winston, qu’en l’année 2050, au plus tard, il n’y aura pas un seul être humain vivant capable de comprendre une conversation comme celle que nous tenons maintenant ? La fonction spéciale de certains mots novlangue comme ancipensée, n’était pas tellement d’exprimer des idées que d’en détruire. On avait étendu le sens de ces mots, nécessairement peu nombreux, jusqu’à ce qu’ils embrassent des séries entières de mots qui, leur sens étant suffisamment rendu par un seul terme compréhensible, pouvaient alors être effacés et oubliés. La plus grande difficulté à laquelle eurent à faire face les compilateurs du dictionnaire novlangue, ne fut pas d’inventer des mots nouveaux mais, les ayant inventés, de bien s’assurer de leur sens, c’est-à-dire de chercher quelles séries de mots ils supprimaient par leur existence. (…)
La fonction spéciale de certains mots novlangue comme ancipensée, n’était pas tellement d’exprimer des idées que d’en détruire. On avait étendu le sens de ces mots, nécessairement peu nombreux, jusqu’à ce qu’ils embrassent des séries entières de mots qui, leur sens étant suffisamment rendu par un seul terme compréhensible, pouvaient alors être effacés et oubliés. La plus grande difficulté à laquelle eurent à faire face les compilateurs du dictionnaire novlangue, ne fut pas d’inventer des mots nouveaux mais, les ayant inventés, de bien s’assurer de leur sens, c’est-à-dire de chercher quelles séries de mots ils supprimaient par leur existence. (…)