Suite au vote des tipeurs, voilà un épisode consacré à la philosophie du langage : c’est un sujet de niche, je n’aurais pas cru que j’oserais y consacrer des épisodes un jour, j’espère que ça vous plaira !
Pour aller plus loin, je vous conseille d’aller voir le cours de François Récanati au Collège de France : le cours du 12 mars en particulier va probablement aborder des sujets similaires.
Voici le texte de Wittgenstein sur l’existence de Moïse :
Si quelqu’un dit : « Moïse n’a pas existé », cela peut signifier différentes choses. Notamment : Les Israélites n’avaient pas qu’un seul guide quand ils ont quitté l’Egypte. – Ou : Leur guide ne se nommait pas Moïse. – Ou : Personne n’a existé qui ait accompli tout ce que la Bible attribue à Moïse. – Ou : Etc., etc. – D’après Russell, nous pouvons dire : Le nom « Moïse » peut être défini au moyen de diverses descriptions. Par exemple, comme « l’homme qui conduisit les Israélites à travers le désert », comme « l’homme qui vécut à cette époque et en ce lieu, et qui reçut le nom de « Moïse » », « l’homme qui, enfant, fut sauvé des eaux du Nil par la fille de Pharaon », etc. Et selon qu’on adopte l’une ou l’autre de ces définitions, la proposition : « Moïse a existé » acquiert un sens différent, et il en va de même pour toutes les autres propositions portant sur Moïse. (…)
Mais quand j’énonce quelque chose au sujet de Moïse, suis-je dans tous les cas prêt à substituer à « Moïse » l’une quelconque de ces descriptions ? Peut-être dirais-je que par « Moïse » j’entends l’homme qui a fait toutes les choses que la Bible attribue à Moïse, ou du moins bon nombre de ces choses. Mais combien ? Ai-je décidé combien de choses devaient se révéler fausses pour que je renonce à ma proposition et la considère comme fausse ? Le nom « Moïse » possède-t-il donc pour moi un emploi fixe et univoquement déterminé dans tous les cas possibles ? – N’est-il pas vrai que j’ai pour ainsi dire toute une série de béquilles en réserve, et que je suis prêt à m’appuyer sur l’une si l’on me retire l’autre, et vice versa ?
(…) J’emploie le nom [Moïse] sans signification fixe. (Mais cela n’est pas plus préjudiciable à son emploi que le serait le fait de se servir, non d’une table à trois pieds, mais d’une table à quatre pieds qui pourrait, de ce fait, être bancal.)
Wittgenstein, Recherches philosophiques, 1953, §79
Un passage de Searle qui présente les grandes lignes de sa théorie du faisceau :
[Les noms propres] ont pour fonction principale de référer ou prétendre référer à des objets particuliers ; mais bien sûr d’autres expressions, à savoir les descriptions définies et les démonstratifs, réalisent aussi cette fonction. Quelle est donc la différence entre les noms propres et les autres expressions à référence singulière ? Contrairement aux démonstratifs, un nom propre réfère sans présupposer aucune mise en scène particulière ou aucune condition contextuelle entourant l’énonciation de l’expression. Contrairement aux descriptions définies, ils ne spécifient en général aucune caractéristique des objets auxquels ils réfèrent. « Scott » réfère au même objet que « l’auteur de Waverley« , mais « Scott » ne spécifie aucune de ses caractéristiques, tandis que « l’auteur de Waverley » réfère seulement en vertu du fait que cette expression spécifie une caractéristique.
(…) Puisque le nom propre en général ne spécifie aucune caractéristique auquel il réfère, comment donc nous présente-t-il cette référence ? Comment une connexion entre nom et objet s’établit-elle jamais ? A ceci, qui me semble être la question cruciale, je veux répondre en disant que, quoique normalement les noms propres n’assertent ni ne spécifient aucune caractéristique, leur usage référentiel présuppose néanmoins que l’objet auquel ils sont censés référer satisfait certaines caractéristiques. Mais lesquelles ? Supposez que l’on demande à ceux qui utilisent le nom « Aristote » de formuler ce qu’ils considèrent comme des faits essentiels et établis concernant Aristote. Leurs réponses seraient un ensemble d’énoncés descriptifs singularisant. De là, ce que je soutiens, c’est que la force descriptive de « C’est Aristote » revient à asserter qu’un nombre suffisant mais jusque là non spécifié de ces énoncés sont vrais de cet objet. (…) Utiliser un nom propre de façon référentielle c’est présupposer la vérité de certains énoncés descriptifs singularisant, mais ordinairement ce n’est pas asserter ces énoncés ni même indiquer lesquels exactement sont présupposés. Et c’est ici que réside la plus grande difficulté. La question de ce qui constitue le critère d’ »Aristote » est en général laissée ouverte ; en effet elle se pose rarement dans les faits, et lorsqu’elle se pose c’est nous, utilisateurs du nom, qui décidons de façon plus ou moins arbitraire ce que ces critères devraient être. Si, par exemple, l’on découvrait que la moitié des caractéristiques attribuées à Aristote appartenaient à un homme et l’autre moitié un autre, lequel des deux dirions-nous qu’était Aristote ? Aucun des deux ? La question n’est pas pour nous tranchée à l’avance.
Mais cette imprécision quant aux caractéristiques qui constituent les conditions nécessaires et suffisantes d’application du nom propre est-elle un pur accident, un produit de négligence linguistique ? (…) L’unique et immense avantage pragmatique des noms propres dans notre langage tient précisément au fait qu’ils nous permettent de référer publiquement à des objets sans être forcé de soulever et résoudre le problème de savoir exactement quelles caractéristiques descriptives constituent l’identité de l’objet. Ils fonctionnent non comme des descriptions, mais comme des crochets sur lesquels pendre des descriptions. Ainsi le caractère élastique des critères des noms propres est-il une condition nécessaire pour isoler la fonction référentielle de la fonction descriptive du langage.
(…)
Nous sommes maintenant en position d’expliquer comment il se fait que « Aristote » a une référence mais ne décrit pas, et pourtant l’énoncé « Aristote n’a jamais existé » ne revient pas à dire seulement que « Aristote » n’a jamais été utilisé pour référer à aucun objet. L’énoncé asserte qu’un nombre suffisant des présuppositions conventionnelles, énoncés descriptifs, associées aux usages référentiels de « Aristote » sont fausses. Savoir au juste quels énoncés sont faux, cela n’est pas encore clair, car les conditions précises qui constituent le critère d’application de « Aristote » n’est pas encore exposée par le langage.
Nous pouvons maintenant résoudre notre paradoxe : les noms propres ont-ils un sens ? Si par là nous demandons si les noms propres sont utilisé pour décrire ou spécifier des caractéristiques des objets, la réponse est « non ». Mais si par là nous demandons si les noms propres sont logiquement connectés avec des caractéristiques de l’objet auquel ils réfèrent, la réponse est « oui, d’une façon élastique ».
Searle, ‘‘Proper names’’, 1958, vol. 67, 266, p.166-173.

 « Dire de ce qui est qu’il n’est pas, et de ce qui n’est pas dire qu’il est, voilà le faux ; dire de ce qui est qu’il est, et de ce qui n’est pas dire qu’il n’est pas, voilà le vrai. »
« Dire de ce qui est qu’il n’est pas, et de ce qui n’est pas dire qu’il est, voilà le faux ; dire de ce qui est qu’il est, et de ce qui n’est pas dire qu’il n’est pas, voilà le vrai. » « La première signification de vrai et de faux semble avoir son origine dans les récits ; et l’on a dit vrai un récit, quand le fait raconté était réellement arrivé ; faux, quand le fait raconté n’était arrivé nulle part. Plus tard, les philosophes ont employé le mot pour désigner l’accord d’une idée avec son objet ; ainsi, l’on appelle idée vraie celle qui montre une chose comme elle est en elle-même ; fausse, celle qui montre une chose autrement qu’elle n’est en réalité. Les idées ne sont pas autre chose en effet que des récits ou des histoires de la nature dans l’esprit. Et de là on en est venu à désigner de la même façon, par métaphore, des choses inertes ; ainsi, quand nous disons de l’or vrai ou de l’or faux, comme si l’or qui nous est présenté racontait quelque chose sur lui-même, ce qui est ou n’est pas en lui. »
« La première signification de vrai et de faux semble avoir son origine dans les récits ; et l’on a dit vrai un récit, quand le fait raconté était réellement arrivé ; faux, quand le fait raconté n’était arrivé nulle part. Plus tard, les philosophes ont employé le mot pour désigner l’accord d’une idée avec son objet ; ainsi, l’on appelle idée vraie celle qui montre une chose comme elle est en elle-même ; fausse, celle qui montre une chose autrement qu’elle n’est en réalité. Les idées ne sont pas autre chose en effet que des récits ou des histoires de la nature dans l’esprit. Et de là on en est venu à désigner de la même façon, par métaphore, des choses inertes ; ainsi, quand nous disons de l’or vrai ou de l’or faux, comme si l’or qui nous est présenté racontait quelque chose sur lui-même, ce qui est ou n’est pas en lui. »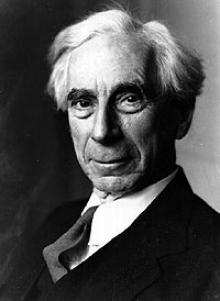 « Il faut noter que la vérité ou la fausseté d’une croyance dépend toujours de quelque chose d’extérieur à la croyance même. Si ma croyance est vraie quand je crois que Charles Ier est mort sur l’échafaud, ce n’est pas en vertu d’une qualité propre à ma croyance, qualité que je pourrais découvrir par simple examen de la croyance ; c’est à cause d’un événement historique d’il y a deux siècles et demi. Si je crois que Charles Ier est mort dans son lit, c’est là une croyance fausse : je peux bien y croire avec force, avoir pris des précautions avant de m’y tenir, tout cela ne l’empêche pas d’être fausse toujours pour la même raison, nullement en vertu d’une propriété qui lui soit propre. Bien que la vérité et la fausseté soient des propriétés des croyances, ce sont donc des propriétés qui dépendent de la relation entre la croyance et autre chose qu’elle, non pas d’une qualité interne à la croyance.
« Il faut noter que la vérité ou la fausseté d’une croyance dépend toujours de quelque chose d’extérieur à la croyance même. Si ma croyance est vraie quand je crois que Charles Ier est mort sur l’échafaud, ce n’est pas en vertu d’une qualité propre à ma croyance, qualité que je pourrais découvrir par simple examen de la croyance ; c’est à cause d’un événement historique d’il y a deux siècles et demi. Si je crois que Charles Ier est mort dans son lit, c’est là une croyance fausse : je peux bien y croire avec force, avoir pris des précautions avant de m’y tenir, tout cela ne l’empêche pas d’être fausse toujours pour la même raison, nullement en vertu d’une propriété qui lui soit propre. Bien que la vérité et la fausseté soient des propriétés des croyances, ce sont donc des propriétés qui dépendent de la relation entre la croyance et autre chose qu’elle, non pas d’une qualité interne à la croyance. « La vérité, dit-on, consiste dans l’accord de la connaissance avec l’objet. Selon cette simple définition de mot, ma connaissance doit donc s’accorder avec l’objet pour avoir valeur de vérité. Or le seul moyen que j’ai de comparer l’objet avec ma connaissance c’est que je le connaisse. Ainsi, ma connaissance doit se confirmer elle-même ; mais c’est bien loin de suffire à la vérité. Car puisque l’objet est hors de moi et que la connaissance est en moi, tout ce que je puis apprécier c’est si ma connaissance de l’objet s’accorde avec ma connaissance de l’objet. Les anciens appelaient diallèle un tel cercle dans la définition. Et effectivement c’est cette faute que les sceptiques n’ont cessé de reprocher aux logiciens ; ils remarquaient qu’il en est de cette définition de la vérité comme d’un homme qui ferait une déposition au tribunal et invoquerait comme témoin quelqu’un que personne ne connaît, mais qui voudrait être cru en affirmant que celui qui l’invoque comme témoin est un honnête homme. Reproche absolument fondé, mais la solution du problème est totalement impossible pour tout le monde. »
« La vérité, dit-on, consiste dans l’accord de la connaissance avec l’objet. Selon cette simple définition de mot, ma connaissance doit donc s’accorder avec l’objet pour avoir valeur de vérité. Or le seul moyen que j’ai de comparer l’objet avec ma connaissance c’est que je le connaisse. Ainsi, ma connaissance doit se confirmer elle-même ; mais c’est bien loin de suffire à la vérité. Car puisque l’objet est hors de moi et que la connaissance est en moi, tout ce que je puis apprécier c’est si ma connaissance de l’objet s’accorde avec ma connaissance de l’objet. Les anciens appelaient diallèle un tel cercle dans la définition. Et effectivement c’est cette faute que les sceptiques n’ont cessé de reprocher aux logiciens ; ils remarquaient qu’il en est de cette définition de la vérité comme d’un homme qui ferait une déposition au tribunal et invoquerait comme témoin quelqu’un que personne ne connaît, mais qui voudrait être cru en affirmant que celui qui l’invoque comme témoin est un honnête homme. Reproche absolument fondé, mais la solution du problème est totalement impossible pour tout le monde. » « Si des axiomes arbitrairement posés ne se contredisent pas l’un l’autre ou bien avec une de ses conséquences, ils sont vrais et les choses ainsi définies existent. Voilà pour moi le critère de la vérité et de l’existence. »
« Si des axiomes arbitrairement posés ne se contredisent pas l’un l’autre ou bien avec une de ses conséquences, ils sont vrais et les choses ainsi définies existent. Voilà pour moi le critère de la vérité et de l’existence. »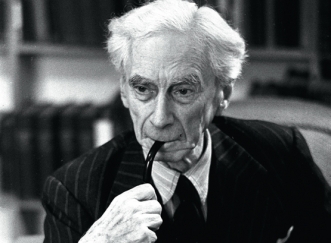 Cette conception bute pourtant sur une, ou plutôt deux, difficultés majeures. La première est qu’il n’y a aucune raison de penser qu’un seul système cohérent de croyances est concevable. Peut-être un romancier doué de l’imagination nécessaire pourrait-il réinventer le passé du monde tant et si bien que ce passé, quoique entièrement fictif, s’ajusterait parfaitement à ce que nous savons. Dans un domaine plus scientifique, il arrive souvent que deux ou plusieurs hypothèses soient également capables de rendre compte de tous les faits connus sur une question ; et malgré l’effort des scientifiques pour découvrir un fait qui puisse disqualifier toutes les hypothèses sauf une, rien n’assure qu’ils puissent toujours y parvenir.
Cette conception bute pourtant sur une, ou plutôt deux, difficultés majeures. La première est qu’il n’y a aucune raison de penser qu’un seul système cohérent de croyances est concevable. Peut-être un romancier doué de l’imagination nécessaire pourrait-il réinventer le passé du monde tant et si bien que ce passé, quoique entièrement fictif, s’ajusterait parfaitement à ce que nous savons. Dans un domaine plus scientifique, il arrive souvent que deux ou plusieurs hypothèses soient également capables de rendre compte de tous les faits connus sur une question ; et malgré l’effort des scientifiques pour découvrir un fait qui puisse disqualifier toutes les hypothèses sauf une, rien n’assure qu’ils puissent toujours y parvenir. Mais, touchant l’incertitude de la philosophie, ce n’est là que la moitié de la vérité. Bien des questions, en particulier celles qui présentent le plus grand intérêt pour notre existence spirituelle, doivent rester insolubles, pour autant qu’on puisse le savoir, à moins que les pouvoirs de l’intellect humain changent radicalement. L’univers présente-t-il une unité de plan et de but, ou n’est-il qu’une rencontre fortuite d’atomes ? (…) Le bien et le mal ont-ils un sens pour l’univers, ou n’ont-ils de sens que pour l’homme ? Ce sont là des questions philosophiques, auxquelles les philosophes ont apporté des réponses variées. Peut être existe-t-il d’autres voies pour découvrir la réponse : mais il semble qu’on ne puisse démontrer la vérité d’aucune des réponses proposées par la philosophie. Et pourtant, aussi mince que soit l’espoir de parvenir à une solution , c’est une partie de la tâche de la philosophie de poursuivre ces interrogations, de nous faire prendre conscience de leur enjeu, d’examiner les différentes approches qu’on peut en avoir, et de garder vivant cet intérêt spéculatif pour l’univers que la connaissance assurée, trop bien établie, peut tuer si l’on s’y laisse enfermer.
Mais, touchant l’incertitude de la philosophie, ce n’est là que la moitié de la vérité. Bien des questions, en particulier celles qui présentent le plus grand intérêt pour notre existence spirituelle, doivent rester insolubles, pour autant qu’on puisse le savoir, à moins que les pouvoirs de l’intellect humain changent radicalement. L’univers présente-t-il une unité de plan et de but, ou n’est-il qu’une rencontre fortuite d’atomes ? (…) Le bien et le mal ont-ils un sens pour l’univers, ou n’ont-ils de sens que pour l’homme ? Ce sont là des questions philosophiques, auxquelles les philosophes ont apporté des réponses variées. Peut être existe-t-il d’autres voies pour découvrir la réponse : mais il semble qu’on ne puisse démontrer la vérité d’aucune des réponses proposées par la philosophie. Et pourtant, aussi mince que soit l’espoir de parvenir à une solution , c’est une partie de la tâche de la philosophie de poursuivre ces interrogations, de nous faire prendre conscience de leur enjeu, d’examiner les différentes approches qu’on peut en avoir, et de garder vivant cet intérêt spéculatif pour l’univers que la connaissance assurée, trop bien établie, peut tuer si l’on s’y laisse enfermer.